
Oxydation, acidité volatile, bretts, gaz, goût de souris : s’agit-il de caractéristiques ou de défauts de certains vins (principalement les vins nature) ? Sans entrer dans le débat pro-anti vins nature et « déviances », décryptons ces termes pour vous donner les clefs.
- Vers une augmentation du nombre de vins déviants et une normalisation de ces défauts ?
- Les vins nature, plus sujets aux défauts du vin ?
- L’oxydation dans le vin
- L’acidité volatile dans le vin : comment la reconnaître, d’où vient-elle ?
- Le gaz carbonique dans le vin : les vins « perlants »
- Les bretts dans le vin
- Le goût de souris dans le vin

1. Vers une augmentation du nombre de vins déviants et une normalisation de ces défauts ?
La souris – le goût de souris -, la « vol' » – acidité volatile -, les bretts – brettanomyces – ou encore l’oxydation, autrefois unanimement considérés comme des défauts du vin se sont beaucoup développés ces dernières années parallèlement à la montée du phénomène des vins nature. En effet produire ce type de vin n’est pas sans risque et réclame beaucoup de rigueur et d’exigences, notamment d’hygiène et une récolte parfaitement saine afin d’éviter les déviances du vin, car produire du vin nature, c’est être « sans filet ». Il est probable que le nombre de vins avec des défauts de ce type ait augmenté ces dernières années ; une croissance qui serait notamment corrélée à l’essor du mouvement des vins nature, mais pas seulement – beaucoup de vignerons évoquant par exemple le rôle potentiel du réchauffement climatique, même si ce dernier demeure encore mal connu. Il est également probable que ces défauts soient aujourd’hui plus connus et plus scrutés aujourd’hui qu’il y a quelques années, du fait d’une sorte de phénomène de mode mais aussi d’une plus grande information sur ces sujets.
Pour autant, depuis quelques années, certains amateurs se sont habitués à ces déviances et vont même jusqu’à les apprécier et les rechercher, à imaginer que ces défauts sont le « vrai » goût du vin. Ce n’est en tous cas pas notre position chez iDealwine et nous continuons de les considérer comme des défauts mais cela ne nous empêche pas évidemment d’adorer les vins naturels : il y a en a tant qui n’ont pas de défauts ou de manière très rare !
Avant de voir en détail ce que sont les défauts comme l’oxydation, les bretts, la volatile et consorts et comment reconnaître ces défauts du vin, au nez comme en bouche, voyons plus en détail cette idée selon laquelle les vins nature seraient plus sujets à ces défauts.
2. Les vins nature, plus sujets aux défauts du vin ?
« J’ai reconnu que c’était un vin “nature”, un nez d’écurie mal tenue et une bouche pleine de gaz et vinaigrée… » Vous avez déjà entendu ce genre de discours de la part de certains amateurs de vin ? Sont-ils plus délicats que d’autres ou les vins “nature” sont-ils plus souvent que les autres sujets à des déviances qui les conduisent parfois directement à l’évier ?
Rappel : qu’est ce que le vin nature ?
Avant d’identifier ces déviances potentielles, faisons un petit point sur la définition d’un vin “nature” et sur leur éventuel lien avec les défauts précédemment cités. Pour de nombreux amateurs, elle se résume à un vin sans soufre. La réalité est sensiblement plus complexe, même s’il n’y a pas de véritable définition officielle de ce que devrait être un vin “nature”. Il n’existe pas de cahier des charges reconnu par exemple par l’administration comme peut l’être une A.O.C. Selon le Syndicat de Défense des Vins Nature’L, qui est sans doute le plus représentatif de ce courant pas très structuré, pour être admis un vin doit être issu de raisins certifiés bio (ou en biodynamie), les vendanges manuelles, les vinifications en levures indigènes, aucun intrant n’est ensuite ajouté, aucun recours à des techniques physiques brutales et contraignantes (osmose inverse, flash-pasteurisation, filtration tangentielle, thermovinification…) n’est toléré, le soufre n’est pas autorisé en vinification, mais le reste à la mise en bouteilles à condition de rester en-dessous de 30 mg/l au total. Pour plus d’informations sur les vins nature, vous pouvez lire notre article « Comprendre le vin nature (ou naturel) : simple mode ou phénomène durable ?« . Notons que depuis 2019, un label existe, celui du Vin Méthode Nature.
Vins nature et vins déviants : quelle corrélation ?
À la base, il n’y a aucune raison pour qu’un vin “nature” ait plus de défauts ou de déviances qu’un vin conventionnel. Pour des raisons très diverses, tous les vins peuvent être sujets à des problèmes, à des défauts. Si le vigneron récolte des raisins pas mûrs ou au contraire plein de pourriture pas noble du tout, qu’il soit conventionnel, en bio ou “nature”, il ne pourra pas produire un vin “nickel”. Et quelle que soit la philosophie d’un producteur un vin pourra être trop boisé, trop alcoolisé, trop extrait, etc. Certains défauts concernent donc tous types de production de vin, comme le goût de bouchon par exemple qui peut aussi bien concerner un vin nature un vin conventionnel.
Pourtant, les vins “nature” par leur mode même de production, plus risqué, avec moins de protections, une sorte de travail « sans filet de sécurité » comme nous le disions, peuvent effectivement être sujets à certains défauts ou déviances (ou du moins perçus comme tels), ils peuvent aussi en développer a posteriori s’ils sont conservés dans de trop mauvaises conditions (notamment de trop fortes chaleur). C’est assez logique : un vin totalement aseptisé sera en quelque sorte figé, tandis qu’un vin dit « vivant » sera plus sujet à évoluer.
Voyons quels sont ces défauts les plus courants.

3. L’oxydation dans le vin : quelle odeur, quel goût, comment la reconnaître ?
Qu’est ce que l’oxydation du vin ?
L’oxydation est une réaction chimique lors de laquelle une substance perd des électrons lors d’une réaction avec une autre substance, généralement l’oxygène. Dans le cas du vin, l’oxydation se développant au contact avec l’oxygène présent dans l’air : une partie de l’alcool présent dans le vin sous la forme d’éthanol se transforme en éthanal puis en acide acétique (composant principal du vinaigre). Cette réaction chimique altère également la couleur du vin : les vins blancs jaunissent et les rouges prennent des teintes tuilées, marrons. C’est un processus naturel et irréversible, qui peut être recherché sur certains vins, dits oxydatifs, de manière maîtrisée, mais qui ne l’est pas sur les autres types de vins.
L’oxydation est notamment favorisée par une absence de soufre en vinification – ce dernier étant justement un antioxydant -, un contact trop poussé avec l’air lors des vinifications ou une ouverture trop prolongée de la bouteille.
Quels arômes et quel goût à un vin oxydé ? Comment reconnaître l’oxydation dans le vin ?
En mettant votre nez sur le blanc que vous avez dans votre verre, vous avez avant tout des arômes de pomme ou de poire blette, voire de cidre, de noix, de curry, que vous pourrez retrouver au nez comme en bouche. Votre blanc est oxydé et cela ne va pas s’améliorer avec le temps… Si c’est un rouge, l’oxydation se traduira par des arômes d’acétate marqués (vernis à ongle) et une bouche plus ou moins vinaigrée, madérisée et des notes animales.
Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez lire notre article « Oxydation, réduction, bouchon : les mauvais goûts du vin passés au crible«
4. L’acidité volatile dans le vin : comment la reconnaître, d’où vient-elle ?
Qu’est ce que l’acidité volatile dans le vin ?
Elle est relativement difficile à distinguer des arômes d’acétate évoqués ci-dessus puisqu’elle est caractéristique du vin qui tourne au vinaigre. C’est l’acétate d’éthyle le responsable , qui donne les fameux arômes de vernis à ongle ou de colle au vin qui est alors dit « acescent ». L’acide acétique peut aussi entrer en jeu, c’est lui qui transforme le vin en vinaigre (à partir de 37g/L selon la norme). Un vin peut contenir l’une de ces acidités volatiles ou bien les deux.
Pourtant l’acidité volatile est quelque chose de naturellement présent dans tous les vins, c’est l’acidité qui est volatile, c’est-à-dire qui s’évaporent facilement à température ambiante. C’est son excès qui peut poser problème. Selon les règles légales elle ne doit pas dépasser 0,98 g/l pour les rouges et 0,88 g/l pour les blancs et les rosés.
D’où vient l’acidité volatile ?
Plusieurs cas de figure possibles : les levures naturelles peuvent produire de l’acide acétique ou de l’acétate d’éthyle au début des fermentations ; ou alors des bactéries lactiques peuvent produire de l’acide acétique à partir des sucres durant la fermentation alcoolique, c’est la « piqûre lactique » ; ou encore, des bactéries acétiques peuvent transformer l’éthanol en acide acétique durant l’élevage, c’est la fameuse « piqûre acétique ». Les facteurs de risque pouvant favoriser l’apparition de l’acidité volatile sont la chaleur, des acidités basses des jus, des sucres élevés
Comment reconnaître l’acidité volatile dans le vin ?
Quand elle est excessive, on sent le nez qui “pique” un peu et la finale en bouche devient brûlante car il s’agit d’une acidité plutôt agressive. Une acidité volatile élevée mais pas trop, peut par contre se révéler bénéfique pour certains vins du sud qu’elle contribue à rafraîchir en bouche. Elle est parfois excessive dans les vins “nature”, favorisée elle aussi par l’absence ou un dosage trop léger de soufre.

5. Le gaz carbonique dans le vin : les vins « perlants »
Qu’est ce qu’un vin perlant ?
Un vin dit « perlant » est un vin dans lequel on ressent une légère effervescence, un léger pétillement, provoqué par la présence de gaz carbonique.
D’où vient le gaz carbonique dans les vins ?
Le gaz carbonique est naturellement produit au cours de toutes les vinifications. Il peut en rester plus au moins au moment de la mise en bouteille. De nombreux vignerons dégazent leurs vins avant l’embouteillage. D’autres ne le font pas, car le gaz carbonique protège naturellement le vin de l’oxydation et permet de réduire les doses de soufre lors de la mise en bouteille, voire de s’en passer complètement. Pour de nombreux amateurs, le côté légèrement perlant d’un vin blanc ou, pire, d’un vin rouge est perçu comme un défaut. Peut-être, mais c’est un défaut que l’on peut facilement corriger ou fortement atténuer, par exemple en carafant vigoureusement le vin en question. D’autres trouvent au contraire cette légère effervescence qui n’altère pas le goût du vin plutôt agréable, apporte un certain rafraîchissement et un dynamisme au vin.
Comment reconnaître un vin perlant ?
Un vin perlant se reconnaît donc à la dégustation par la présence de gaz carbonique : un léger pétillement et picotement sur langue. Il peut également se reconnaître dès l’ouverture de la bouteille si l’on entend un léger « pop » démontrant là-aussi la présence de gaz qui aura créé une légère pression dans la bouteille.
6. Les bretts dans le vin
Qu’est ce que les bretts dans le vin ?
Les brettanomyces sont des levures qui peuvent contaminer le vin ; ces dernières sont des levures très répandues, notamment au chais et parfois même sur les raisins.
Comment reconnaître les bretts dans le vin ?
Quand votre vin (souvent un rouge car ce défaut y est sans doute plus perceptible), dégage des odeurs phénoliques (encre, cuir, écurie, sueur) puissantes, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un vin bretté, infesté de brettanomyces, une levure qui prend le dessus sur les autres au cours de la vinification.
D’où viennent les bretts dans le vin ?
Là aussi, les facteurs de risques sont des acidités basses, des niveaux d’alcool élevés et peu de protection au SO2 (les vins nature sont donc plus soumis à ce risque), la présence de sucres résiduels, une mauvaise hygiène au chais…
Il s’agit d’une déviance qui n’est pas spécifique aux vins “nature”, mais peut-être un peu plus fréquente chez ces derniers quand l’hygiène du chai n’est pas parfaite et que l’absence de soufre n’a pas permis d’inhiber ces fameuses brettanomyces. Dans d’autres boissons comme certains type de bières, les lambics (bière de fermentation spontanée) et les geuzes (assemblage de Lambics), c’est justement ce goût typique de bretts qui est recherché.
7. Le goût de souris dans le vin

Qu’est ce que le goût de souris dans le vin ?
C’est un défaut dont on parlait peu autrefois et qui est devenu “à la mode” ces dernières années, comme nous le disions précédemment soit par augmentation de sa fréquence, soit par une meilleure connaissance du phénomène – il s’agit probablement d’un peu des deux. Les méchantes langues vous diront qu’on en parle plus parce qu’il y a de plus en plus de vins “nature”. Il y a effectivement probablement un lien… Pour autant, ce défaut a toujours existé, même s’il semblait moins fréquent il y a quelques années.
Il s’agit d’un défaut d’origine microbienne qui se développe lors des vinifications et qui n’a évidemment rien à voir avec l’animal.
Comment reconnaître le goût de souris ?
Olfactivement, c’est un défaut très dur à détecter, il se manifeste surtout en bouche. De plus, il n’apparaît pas immédiatement en bouche mais uniquement en rétro-olfaction, après avoir avalé le vin ou l’avoir recraché si on est en dégustation. Il se caractérise par un goût assez marqué de peau de saucisson ou de pop-corn, certain parlent de serpillère ou encore de cacahuètes et même – et c’est dc là qu’il tire son nom – d’urine de rongeurs. Ce défaut peut être discret ou au contraire prendre le dessus sur tous les autres arômes du vin. Il est de plus très dépendant de l’acidité de la salive du dégustateur et peut donc ne pas être perçu de la même manière par deux personnes goûtant le même vin. Enfin, il est plus facilement décelable dans les blancs que dans les rouges. Dernier point qu’il est important de souligner : contrairement à de nombreux autres défauts, le goût de souris disparaît normalement au bout d’un certain temps de bouteille (entre un an et deux/trois ans), il s’agit d’un défaut passager ; si vous ouvrez une bouteille avec un goût de souris et que vous avez d’autres bouteilles de ce vin, conservez-les quelques années et le problème devrait passer. En revanche, une fois la bouteille ouverte, son intensité à tendance à s’accroître assez rapidement.
D’où vient le goût de souris de certains vins ?
Si le phénomène est encore mal compris, on sait que son origine est microbienne et qu’il est dû au développement de bactéries indésirables (bretts, lactobacilles – des bactéries lactiques) ; certains vignerons pensent qu’il est en croissance à cause du réchauffement climatique qui fait baisser les acidités et augmente parallèlement le potentiel aromatique du goût de souris. Il semblerait que les premiers résultats de la recherche aillent également dans ce sens. De plus, la baisse des quantités de SO2 diminue également la protection contre ce défaut.
Après ce tour d’horizon, probablement pas complet car de multiples déviances sont possibles sur tout vin, terminons par une polémique qui agite parfois le monde du vin et qui oppose ceux qui dénigrent les vins “nature” car toujours remplis de défauts selon eux, et le camp des “naturistes” extrémistes qui estiment qu’un vin sans défaut ne peut pas être véritablement “nature”. Comme souvent, la vérité se situe, à notre humble avis, quelque part entre ces deux extrêmes selon nous. Il est clair que pour produire un vin “nature” sans défauts relève d’une exigence absolue à toutes les étapes : vendange parfaitement saine, hygiène absolue dans le chai, vinifications sans violence et sans manipulations excessives. De nombreux vignerons de talents arrivent à produire des vins nature sans défauts ou du moins dans des cas qui restent rarissimes.
Certains d’entre vous ont-ils un jour tenté de faire du vin vous-mêmes, de façon complètement artisanale dans votre cuisine ? Logiquement, vous avez dû produire… du vinaigre. Il faut aussi avoir l’honnêteté, l’humilité de reconnaître un point : si vous trouvez dans un vin “nature” les défauts évoqués plus haut, c’est qu’il est tout simplement produit par un vigneron qui ne maîtrise pas parfaitement le process exigeant décrit ci-dessus. Pour autant, certaines caractéristiques citées ci-dessous transforment en partie le vin sans vraiment l’altérer : c’est par exemple le cas des vins parlants. Si l’on peut alors débattre de sa nature de défaut ou non, il n’en reste pas moins certains que pour certains amateurs, cela ne sera en rien dérageant, voire, cela sera perçu positivement.
Mais attention, il existe aujourd’hui fort heureusement une pléiade de vignerons produisant des vins “nature” sans le moindre défaut, et ce dans presque toutes les appellations. Le phénomène va en s’amplifiant, car le cercle vertueux des vignerons nature talentueux, s’inspirant les uns des autres, ne fait que s’élargir. Un grand bonheur pour les amateurs. Comment les identifier ? Nous ne saurions trop vous recommander d’écouter les conseils… d’iDealwine bien sûr, de vos amis, ou de la presse pour ne pas vous tromper dans vos choix et remplir votre cave des meilleurs vins “nature” et sans défauts présents sur le marché. Mais ne tombez surtout pas dans la simplification « vin nature = vin déviant », ce serait tellement dommage !
A lire également :
Le soufre (ou les sulfites) dans le vin, ça sert à quoi ?

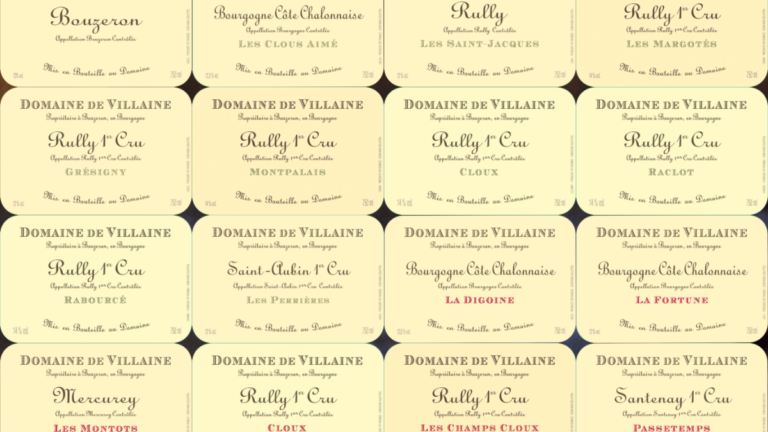


Exhaustif, clair, ouvert. Bravo : les multiples aléas du chai rendent hasardeux toute généralisations…
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre joli commentaire,
Très bonne journée
L’équipe iDealwine