

Les rivalités entre vignobles du Nord et du Sud s’exacerbent à partir du 12e, lorsque les pays de la mer du Nord manifestent un besoin supérieur en vin. Les vallées de la Saine, du Rhin voire de la Moselle ne suffisent plus à couvrir leurs approvisionnements et les vignobles du Centre, de l’Auxerrois, de l’Anjou et du Sud-Ouest commencent à leur damer le pion. Ces vins séduisent pour leur puissance et leur structure plus tannique, bénéficiant d’un climat plus ensoleillé. Le témoignage de l’évêque de Paris, Guillaume d’Auvergne, est à ce sujet éloquent : il déclare devoir couper son vin de Saint-Pourçain, d’Angers ou d’Auxerre afin d’en tempérer la force ! Ces « vins forts » ne devaient pourtant pas dépasser les 10°. Le vin d’Argenteuil, si prisé en son temps par Philippe Auguste, est désormais dépassé. Auxerre, Beaune, La Rochelle, la Gascogne briguent la première place, et la disputent à Saint-Pourçain, alors en état de grâce, préféré du pape et du roi.
Le champagne n’étant pas encore né, les vignerons du Nord perdent peu à peu leur hégémonie.
Les publicitaires du Moyen-Âge
La médecine est le premier défenseur du vin à cette époque. Présenté comme une source de santé, il avait toutes les vertus : favoriser la digestion, clarifier le sang, drainer la circulation sanguine. Bref, c’est un breuvage curatif qui entre dans la composition de nombreux remèdes. Ainsi, l’approbation du médecin renforçait la notoriété d’un vin. En quelque sorte, le médecin, malgré lui, en était le meilleur ambassadeur. Si par malheur l’approbation n’est pas donnée (le vin de Châlon accusé par exemple de faire gonfler le ventre ou celui d’Etampes de donner la goutte), les breuvages sont voués à l’excommunication. Les vins de la Côte d’Or bénéficièrent quant à eux d’une belle renommée assise par Philippe le Hardi qui déclarait à leur propos qu’ils n’avaient pas leur pareil pour « nourrir et sustenter la créature humaine ».
Au-delà de ses vertus médicinales, le vin était aussi et surtout vanté comme un don de la nature, indépendamment des soins apportés à la culture de la vigne. Serait-ce là les prémices de la notion de terroir ? On peut le croire en notant que les Orléanais, pour recommander leur vin à Charles VII, n’hésitaient pas à en rehausser le prestige en le définissant comme « une émanation d’un terroir doté, par le Créateur, de vertus particulières« . Dans le même ordre d’idée, les vignerons de Beaune n’hésitent pas à affirmer, lors d’une controverse engagée entre les mérites des vins de Bourgogne et de Champagne, que leur vin est si bon en raison de la « bonne nature de l’air et de la terre, d’une exposition au soleil des plus favorables ».
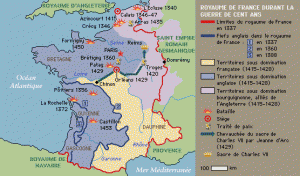
Plus c’est loin, meilleur c’est
Reste à régler la question du transport. En ces temps obscurs où le polystyrène et le colissimo n’avaient pas encore franchi la porte des esprits, et que le chemin de fer n’existait pas surtout, l’acheminement des vins restait le point épineux de sa conservation. Il arrivait fréquemment que le trajet lui était largement préjudiciable. Toute l’astuce consistait alors à faire croire que le nectar gagnerait des galons en route et qu’il serait donc bien meilleur à l’arrivée qu’au départ (un peu ce qu’on essaie de nous faire croire avec les Primeurs, supposés bien meilleurs deux ans plus tard lorsque le prix aura quadruplé). Le poète Guillaume Le Breton, pionnier de la réclame ante-Piou-Piou, célèbre le vin d’Issoudun en latin dans le texte et assure carrément que ce vin gagne d’autant plus en force qu’il vient de loin… (« quantoque magis portatur eo fit fortior« ). Imaginez le nombre de palettes qu’on peut raisonnablement passer en Chine aujourd’hui avec ce genre de discours. Mais aliam vitam, alio mores comme disait l’autre. Le publicitaire de l’époque ne reculant devant aucune ruse, on a aussi l’exemple des vins du Jura et de la Côte d’Or, tributaires exclusivement de la voie terrestre, et qui s’amélioraient – soi-disant- avec « les secousses du roulage »…
Ceux qui exportaient par la mer, pas à court d’argument, affirmaient que c’était l’air marin et le doux roulis qui relevaient la qualité des vins.
Voyez donc ensuite le raisonnement qui en découle : rien ne sert de faire un bon vin, encore faut-il l’exporter le plus loin possible ! Car c’est là que le petit jus va se transformer en nectar. Les Mâconnais, partant de ce principe, justifiaient ainsi leurs ventes vers le Noooooord.
En 1829, Cochard et d’Aigueperse écrivent dans leur Notice sur le canton de Beaujeu que plus les vins du Beaujolais « vont au Nord, et plus ils gagnent en qualité ». On en a transporté jusqu’à Saint-Petersbourg, et l’on assure qu’ils y sont à peine reconnaissables, tant ils s’améliorent dans le trajet ».
Ces adages continuèrent de perdurer jusqu’au début du 20e siècle. Vers 1900, à Bordeaux, on accordait une importance particulière au vin dit « retour des Indes » écrit Roger Dion. Il s’agissait d’un vin qui avait traversé l’Atlantique à deux reprises. Dans le même temps, les vignerons angevins s’efforçaient de faire reconnaître la supériorité du vin d’Anjou « retour de Chine ».

Le roi comme prescripteur suprême
Mais la propagande la plus puissante provenait d’en haut, des grands de ce monde, monarques en premier lieu. Un peu à rebours de ce qui se pratique aujourd’hui, les rois vantaient les mérites des produits de leur pays à leurs homologues venus leur rendre visite. Ainsi de Philippe Auguste qui, en 1201, ouvrit sa cave personnelle à Jean Sans Terre de passage sur Paris. Et les petits présents qui scellent l’amitié, offerts à ces occasions n’oubliaient pas, outre les tissus et les objets d’or et d’argent, les bonnes bouteilles (ou plutôt les fûts).
Comme toujours, qu’un vin soit servi lors d’une grande réception et offert à un grand de ce monde, en particulier au roi d’Angleterre, arrangeait fort les affaires du vigneron et plus largement de sa région. C’est ainsi que les vins d’Issoudun, servis au festin d’apparat que donna Louis IX en 1241 pour fêter l’entrée en chevalerie de son frère Alphonse de Poitiers, furent-ils prisés.
En somme, bénéficier du témoignage de l’estime du roi représentait un gage de succès indiscutable. C’est pourquoi à la cour de France, à partir du 13e siècle, le « bouteiller », c’est-à-dire le responsable des achats de vin pour la table royale, est devenu l’un des plus intimes conseillers du souverain.
En réalité, le choix d’un vin était avant tout et surtout une décision politique. Acheter les vins d’une région en particulier revenait à solliciter indirectement l’appui des vignerons et notables locaux, et donc à les inciter à servir la politique du roi. Ainsi du roi d’Angleterre qui fit en 1359 de grandes provisions de vins de la région de Toulouse, afin d’encourager le soutien des villes du haut bassin de la Garonne dont la fidélité lui était nécessaire.
Rois et grands seigneurs ont donc largement contribué, chacun à leur façon, au commerce du vin au Moyen-Âge. Car au-delà de leurs qualités intrinsèques, ces vins vantés par les grands de ce monde l’étaient aussi beaucoup pour des raisons politiques. En quelque sorte, et dans une certaine mesure, ces rapports politico-viticoles participèrent de la formation de l’unité française.
Source :
Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au 19e siècle, CNRS Editions.



